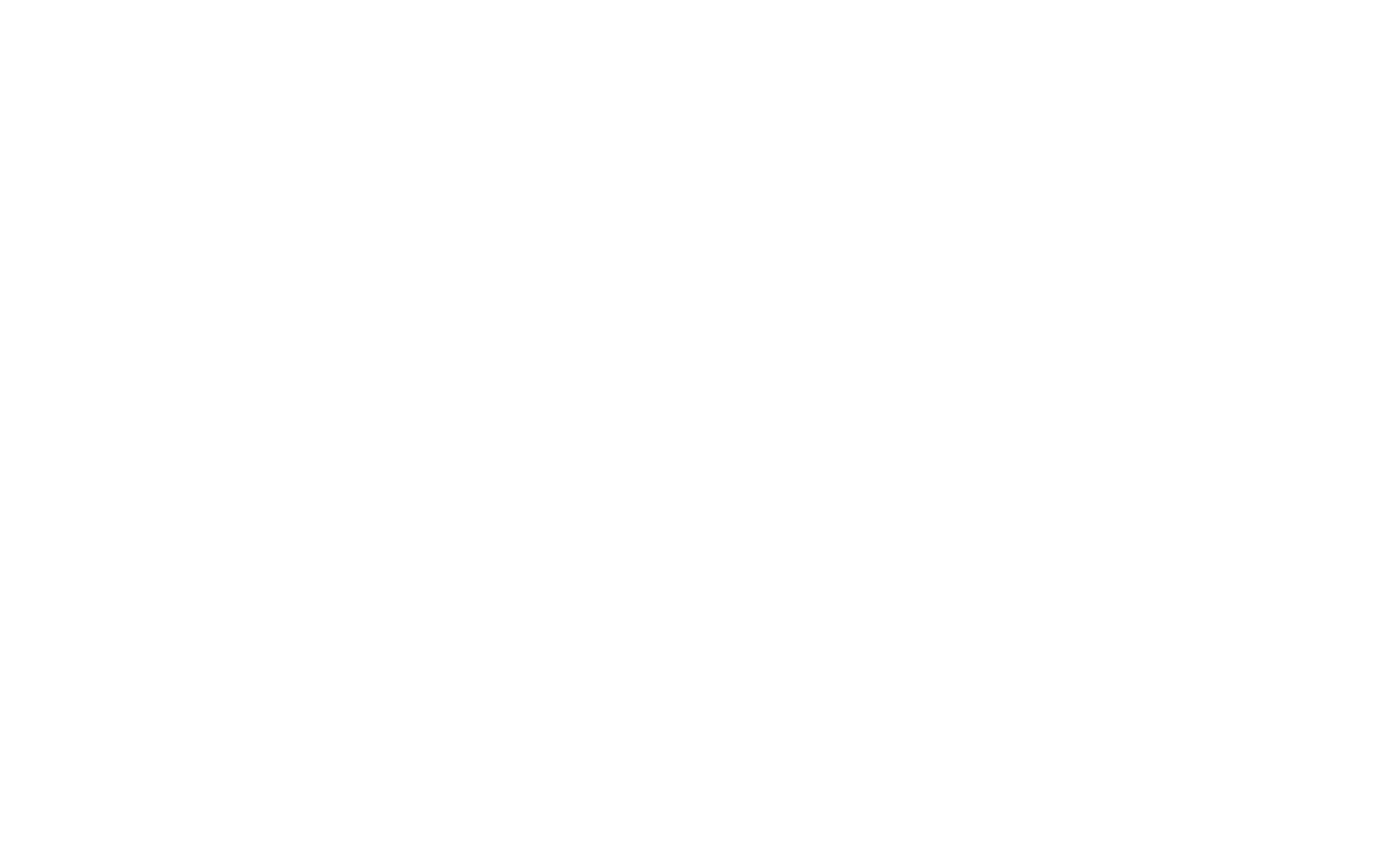La pandémie, l’usage problématique de l’internet et les troubles alimentaires
Récemment, plusieurs études ont démontré que le contexte de la crise sanitaire a provoqué une hausse considérable des personnes vivant simultanément des problèmes de santé mentale et troubles d’usage de substances psychoactives. Le confinement, de pair avec plusieurs changements dans les interactions sociales, ont affecté directement la vie des gens vivant avec de tels troubles concomitants. Cette situation est notamment associée à une augmentation du nombre de cas de personnes présentant un double diagnostic de dépendance et de troubles des conduites alimentaires (TCA)[1].
L’impact de la pandémie sur les troubles alimentaires
Les troubles alimentaires constituent en soi un problème de grande envergure dû à leur association à un taux de morbidité et de mortalité très élevé[2]. La pandémie a aggravé la présence des troubles d’usage de substances, comme l’alcool par exemple, chez les personnes atteintes d’un trouble alimentaire. Parmi divers facteurs, une cause possible est l’intensification synchrone de l’usage problématique des réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux : passe-temps ou dépendance ?
Un autre effet néfaste de la pandémie a été l’augmentation de l’usage d’internet1. La distanciation et le confinement ont contribué à l’utilisation des réseaux sociaux comme moyen principal de communication. Dans certains cas, un usage excessif de l’internet peut aussi s’exprimer comme une dépendance : il s’agit de la cyberdépendance[3].
À l’instar d’autres troubles liés à l’usage de substances psychoactives, les personnes atteintes de TCA sont plus susceptibles d’être touchées par la cyberdépendance[4]. L’utilisation des réseaux sociaux peut être plus courante chez ce groupe de personnes, se présentant alors comme une stratégie d’évitement des émotions négatives et une manière d’accroître leur sentiment d’appartenance à un groupe[5]. Un usage exacerbé, combiné à plusieurs autres sources de stress issues du contexte pandémique, pourrait contribuer au développement d’une dépendance.
Un cercle vicieux
De la même manière que les personnes vivant avec un TCA possèdent une plus forte tendance à démontrer des signes de cyberdépendance, l’usage problématique de réseaux sociaux se présente également comme un facteur qui contribuerait à l’apparition de troubles alimentaires[5]. Des études démontrent que l’exposition aux publications en ligne augmente l’insatisfaction corporelle et la croyance d’une morphologie physique idéale. De plus, les réseaux sociaux contribuent aussi à l’intériorisation de certaines habitudes alimentaires, pas nécessairement saines ou applicables à tous.
Toutefois, il est important de considérer que plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’apparition d’un trouble alimentaire ou à un usage problématique de l’internet. Comme pour d’autres types de troubles concomitants, de l’aide spécialisée est nécessaire afin d’assister les personnes touchées par de telles situations. Les différents projets du laboratoire de recherche dirigé par le Dr. Didier Jutras-Aswad s’inscrivent dans cette perspective et contribuent à améliorer la compréhension des troubles concomitants et de leurs mécanismes sous-jacents, ce qui permet en revanche d’identifier les meilleures stratégies d’intervention clinique à adopter pour améliorer et étendre les options de traitement des individus vivant avec une problématique de troubles concomitants.
[1] Rodgers, R. F., Lombardo, C., Cerolini, S., Franko, D. L., Omori, M., Fuller‐Tyszkiewicz, M., Linardon, J., Courtet, P., & Guillaume, S. (2020). The impact of the COVID‐19 pandemic on eating disorder risk and symptoms. International Journal of Eating Disorders, 53(7), 1166–1170. https://doi.org/10.1002/eat.23318
[2] Ioannidis, K., Hook, R. W., Wiedemann, A., Bhatti, J., Czabanowska, K., Roman-Urrestarazu, A., Grant, J. E., Goodyer, I. M., Fonagy, P., Bullmore, E. T., Jones, P. B., & Chamberlain, S. R. (2022). Associations between COVID-19 pandemic impact, dimensions of behavior and eating disorders: A longitudinal UK-based study. Comprehensive Psychiatry, 115, 152304. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2022.152304
[3] Achab S. Zullino DF, Thorens G. Usage problématique d’Internet, la “Cyberaddiction” nous entoure. Neurologie & Psychiatrie 2013 ; 11(5) : 23-27
[4] Ali, A. M., Hendawy, A. O., Abd Elhay, E. S., Ali, E. M., Alkhamees, A. A., Kunugi, H., & Hassan, N. I. (2022). The Bergen Facebook Addiction Scale: its psychometric properties and invariance among women with eating disorders. BMC Women’s Health, 22(1).
[5] Jahan, I., Hosen, I., al Mamun, F., Kaggwa, M. M., Griffiths, M. D., & Mamun, M. A. (2021). How Has the COVID-19 Pandemic Impacted Internet Use Behaviors and Facilitated Problematic Internet Use? A Bangladeshi Study. Psychology Research and Behavior Management, Volume 14, 1127–1138. https://doi.org/10.2147/prbm.s323570