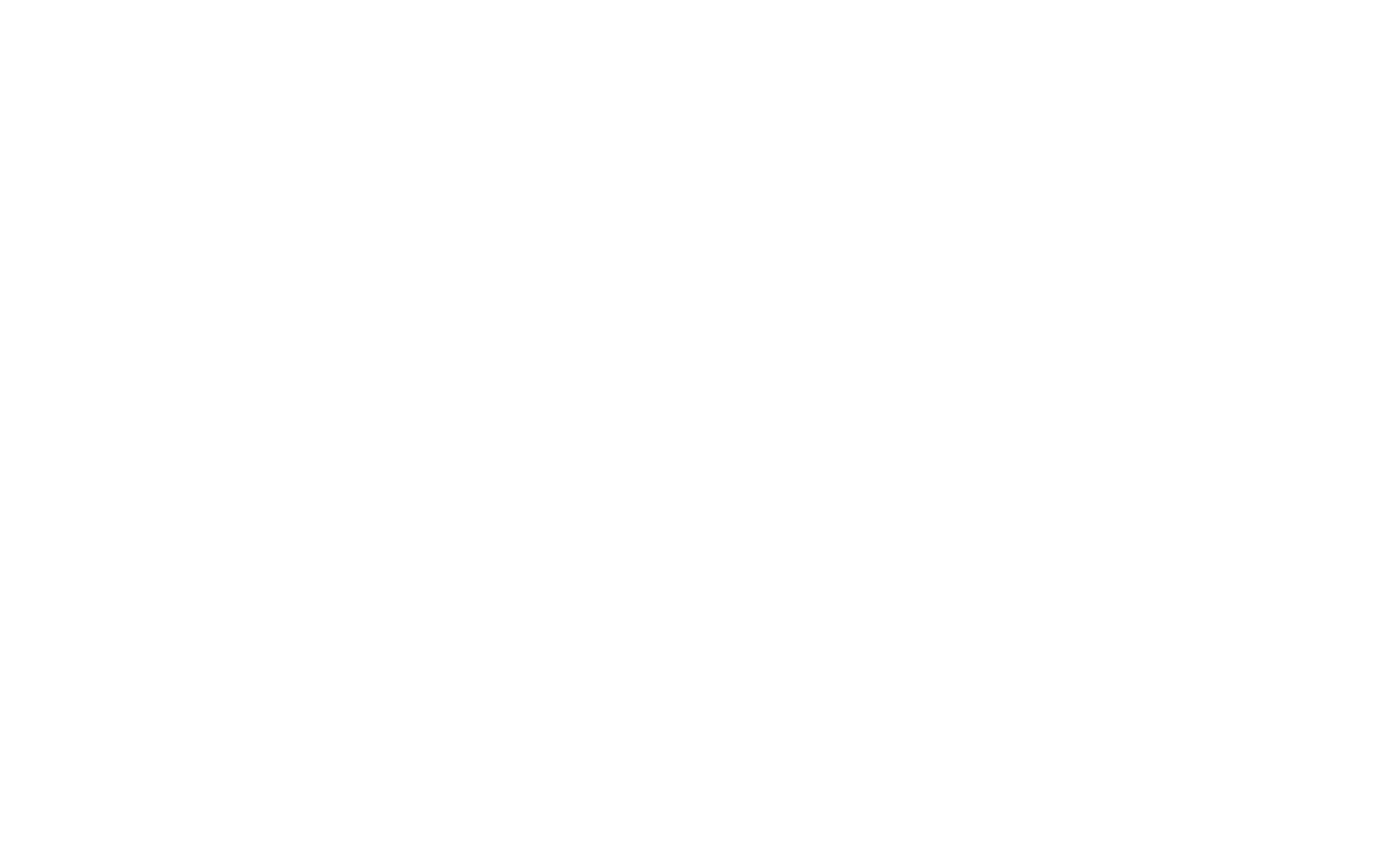Pourquoi consomme-t-on du cannabis?
Depuis sa légalisation au Canada en 2018, le cannabis fait désormais partie du paysage culturel et sociétal québécois. En 2024, près d’une personne sur cinq âgée de 15 ans et plus rapportait en avoir consommé au cours des 12 derniers mois (1). Cependant, derrière cette statistique se cache une question essentielle : pourquoi les gens consomment-ils du cannabis?
Les raisons sont variées. Pour certains, c’est avant tout une recherche de plaisir ou de détente. D’autres l’utilisent pour réduire le stress, mieux dormir ou encore soulager des douleurs physiques (2,3). Chez les jeunes adultes, la curiosité et l’influence des amis jouent aussi un rôle important (4). Enfin, certaines personnes ayant des troubles anxieux ou dépressifs rapportent s’en servir comme une forme d’automédication (5).
Toutefois, ces effets recherchés peuvent varier selon les individus et même au fil du temps. Le cannabis agit sur le système endocannabinoïde (SEC), qui régule l’équilibre interne du corps. Cela explique que les effets puissent être bi-directionnels : une même substance peut, selon la dose, le contexte et la personne, réduire ou au contraire augmenter l’anxiété; favoriser l’endormissement, mais aussi, dans certains cas, perturber le sommeil. De manière générale, les doses élevées de THC sont surtout associées à la fatigue et à la somnolence, mais des situations particulières (par exemple lors de l’arrêt de consommation ou chez certaines populations cliniques) peuvent s’accompagner d’insomnie. Cet aspect souligne l’importance de considérer ce qui est consommé, comment et quand, afin de limiter les effets indésirables et de maximiser les bienfaits potentiels (6–8).
Le contexte social influence aussi beaucoup la consommation. Des études montrent que l’isolement, un faible revenu ou encore le manque de soutien augmentent la probabilité d’utiliser le cannabis comme stratégie pour « mieux faire face » (8). Cela montre bien que la consommation ne dépend pas seulement des préférences individuelles, mais aussi des conditions de vie et du bien-être global de la personne.
En gros, il existe une multitude de raisons derrière l’usage du cannabis. Comprendre ces motivations est essentiel pour mieux prévenir les consommations problématiques et en optimiser les bénéfices. Offrir de l’information claire sur les risques, fournir de l’accompagnement personnalisé et des trucs de consommations à moindre risque, proposer des alternatives pour gérer le stress et améliorer l’accès à des ressources de soutien peuvent aider à réduire les conséquences négatives liées au cannabis, mieux comprendre la réalité des personnes qui en font usage et améliorer les bénéfices thérapeutiques.
Article par Fares Kadous
Références
Statistique Canada. Enquête canadienne sur le cannabis, 2024. Ottawa : Gouvernement du Canada; 2024. Disponible sur : https://www.statcan.gc.ca/
Lee CM, Neighbors C, Woods BA. Marijuana motives: Young adults’ reasons for using marijuana. Addict Behav. 2007;32(7):1384-94. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17097817/
Bonn-Miller MO, Harris AH, Trafton JA. Prevalence of cannabis use disorder diagnoses among veterans in 2002, 2008, and 2009. J Subst Abuse Treat. 2012;43(1):163-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21261407/
Scholes-Balog KE, Hemphill SA, Patton GC, Toumbourou JW. Cannabis use and related harms in the transition to young adulthood: A longitudinal study of Australian secondary school students. Drug Alcohol Rev. 2016;35(2):161-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23522345/
Lev-Ran S, Imtiaz S, Rehm J, Le Foll B. Exploring the association between lifetime prevalence of mental illness and transition from first use to dependence on cannabis. Compr Psychiatry. 2013;54(7):850-6.
Volkow ND, Baler RD, Compton WM, Weiss SRB. Adverse health effects of marijuana use. N Engl J Med. 2014;370(23):2219-27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24897085/
Bahorik AL, Sterling SA, Campbell CI, Weisner C, Ramo D, Satre DD. Medical and non-medical marijuana use in depression: Longitudinal associations with suicidal ideation, everyday functioning, and psychiatry service utilization. J Addict Med. 2017;11(2):136-43. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30086434/
Fergusson DM, Boden JM. Cannabis use and later life outcomes. Addiction. 2008;103(6):969-76. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18482420/